Utilisateur:Clems L32019/Brouillon

La guerre contre-révolutionnaire française au Cameroun (1956-1970) est l'action militaire élaborée et menée par les autorités coloniales françaises puis par le gouvernement camerounais contre la rébellion de l'UPC. Elle se focalise sur les deux principales zones de contestation : la Sanaga-Maritime et le pays Bamiléké.
L'éviction répétée de l'UPC des élections par les autorités coloniales françaises conduit au soulèvement des upécistes et engendre une radicalisation des modes d'actions des rebelles. Première région concernée par les troubles, la Sanaga-Maritime fait l'objet d'une politique spécifique : la ZOPAC. Cette zone militaire est organisée de manière à séparer les « populations saines » et les « populations contaminées ».
Les équipes françaises déployées au Cameroun dans le cadre de la répression ont, pour l'essentiel, officié en Indochine. Pour les administrateurs civils et militaires, l'échec des méthodes employées contre la répression indochinoise marque profondément leur action et détermine une nouvelle approche de la guerre contre-révolutionnaire. Le Cameroun est l'occasion d'appliquer cette nouvelle doctrine.
L'insurrection camerounaise éclate parallèlement à la guerre d'Algérie. La métropole concentre alors l'essentiel de son attention vers ce conflit, ce qui explique partiellement son oubli en France. L'Etat français a longtemps nié l'existence des massacres comme en témoigne la visite du Premier ministre François Fillon à Yaoundé en 2009. Toutefois, lors de sa visite officielle en juillet 2015, le président de la République française François Hollande a reconnu l'existence d'exactions et annoncé l'ouverture des archives.
Contexte modifier
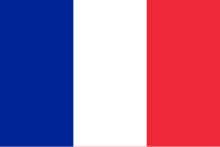
La guerre d'Indochine : une première expérience de la guerre révolutionnaire modifier
Les difficultés de l'administration militaire et civile en Indochine (1946-1954) modifier
L’échec de la précédente répression en Indochine conduit les autorités coloniales à ne pas reproduire les mêmes erreurs au Cameroun. L’initiateur de la doctrine de la guerre révolutionnaire (DGR) demeure Charles Lacheroy dont le commandement en Cochinchine lui a permis de développer ses thèses. Thèses dont la renommée fait de lui un enseignant en la matière auprès de ses pairs.[1] Ses travaux menés sur la « guerre psychologique » ouvrent la voie à des disciples sensibles à ses enseignements. Il s’agit alors de confier l’opération à un personnel qui a pu réaliser ses essais en Indochine. Ces professionnels de la contre-insurrection qui se retrouvent au Cameroun ne manquent pas d’inspiration. On peut notamment citer le colonel Jean Lamberton qui prend la direction des opérations militaires en Sanaga-Maritime et Jean Lecomte, un ancien général de l'armée d'Armistice durant la Seconde Guerre mondiale. L’année 1957 marque le début de la répression de l’insurrection upéciste, débuté en 1956, et donc l’application de la doctrine de la guerre révolutionnaire. Région d’Um Nyobe, la Sanaga-Maritime devient le théâtre de la mise en pratique froidement rationnelle de la DGR en milieu tropical. Tandis qu’Um Nyobe dénonce des « opérations de guerre de grande envergure » l’armée française considère qu’il s’agit d’opérations de « maintien de l’ordre » musclées et pas encore de guerre. Cette idée renvoie au refus des autorités françaises de désigner les « événements » d’Algérie. A ce titre, la bataille d’Alger sert notamment de vitrine internationale aux concepteurs de la DGR. Les bases de la théorie de la guerre subversive sont anciennes[2]. Déjà, au XIXème siècle, l'administrateur colonial Joseph Gallieni posait le premier principe selon lequel s'il y a des moeurs et des coutumes à respecter, il y a aussi des mœurs et des rivalités qu'il faut démêler et utiliser à notre profit, en les opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les unes pour mieux vaincre les autres.

La guerre d'Indochine est un grand électrochoc pour l'armée française, déjà mal remise de sa défaite de 1940 [3]. Cette nouvelle défaite la contraint à remettre en cause toute sa doctrine militaire, toutes ses certitudes tactiques et stratégiques. C'est de cette révision que surgit la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire ou guerre contre-subversive. Appliquée dès le début du conflit algérien, elle est peu après étendue au territoire camerounais. En décembre 1955, le Haut-commissaire au Cameroun français André Soucadeux est remplacé par Roland Pré[4]. Le nouvel administrateur se donne six mois comme délai afin de concrétiser son objectif de casser le mouvement nationaliste camerounais. Un mois après sa prise de fonction, il fait adresser à tous les administrateurs du territoire une brochure du colonel Charles Lacheroy consacrée à l'Indochine : Une leçon de guerre révolutionnaire. Dans l'esprit des autorités coloniales, les références à l'expérience indochinoise demeure omniprésente.
La théorie de la «guerre contre-subversive» du colonel Charles Lacheroy modifier
La DGR est menée conjointement par les autorités civiles et militaires, avec toutefois prééminence de la hiérarchie militaire[5]. Cette doctrine repose sur une idée de base : il faut couper les insurgés de la population, en contrôlant une partie de celle-ci dans des camps de regroupement. Une distinction aussi brutale des populations « contaminées » et populations « saines » permet de justifier l’élimination des premières et l’endoctrinement des secondes. D’une manière générale, la guerre contre-subversive suppose une volonté de contrôle du corps social, dans toutes ses activités.
La DGR est également une guerre du renseignement. En effet, le renseignement devient un élément central dans une guerre qui se joue au sein même de la population. Afin d’obtenir tous types de renseignement, la police ou l’armée ont recours à des séances « d’interrogatoires poussés » sur les prisonniers, intégrant ce processus dans une guerre psychologique. Bien que le mot soit banni du vocabulaire officiel, il s’agit de torture. L’objectif est de rétablir symboliquement l’ordre colonial ébranlé. Par ailleurs, la DGR passe par le recrutement de supplétifs locaux. L’ambition est de faire prendre en charge la répression par la population elle-même et montre ainsi que les colonisés acceptent et participent à leur propre asservissement. Ainsi, Jean Lamberton précise lors de la répression camerounaise : "Il faut mouiller les populations le plus possible avec nous". L'administration coloniale encourage la création de milices d'autodéfense qui se muent rapidement en milices offensives contre les rebelles. Enfin, la DGR applique une censure stricte de la presse et orchestre l’information par les autorités. Au-delà de ces pratiques, il existe un mimétisme entre les techniques utilisées par les deux camps puisque la DGR est supposée se justifier par les méthodes de l’adversaire. Ainsi, le général Jacques Hogard, disciple de Charles Lacheroy et de sa doctrine de la guerre contre-révolutionnaire : « A nous, imitant les peuples européens du début du XIXème siècle, de nous mettre à l’école de l’ennemi ». Toutes ces pratiques étant incompatibles avec les règles de l’Etat de droit, elles nécessitent une législation d’exception. Le commandement militaire prend le pas sur l’administration civile. La fin de la IVème République se révèle propice à ce changement en raison d’une part, de l’instabilité successive des gouvernements, mais également du sentiment grandissant au sein de l’armée française d’un sentiment d’abandon par les politiques et l’opinion publique. La classe politique leur demandant de maintenir l’ordre à tout prix en Algérie en détournant les yeux des méthodes déployées et sans en assumer les conséquences.
Le Cameroun : les prémices de la rébellion de l'UPC modifier
Le développement de l'UPC mené par Ruben Um Nyobe modifier

Constitué le 10 avril 1948 à Douala, l'UPC n'a pas été fondée par Um Nyobe[6]. Aux inspirations marxisantes, elle en appelle directement à l'ONU, le Cameroun étant sous sa tutelle afin de demander la révision des accords de tutelle, la réunification des deux Cameroun, ainsi que la fixation d'une date pour donner l'accès à l'indépendance politique du Cameroun.[7]Le parti se créé autour du triple mot d'ordre réunification,indépendance et progrès des conditions de vie[8]. L'UPC fait rapidement souche dans à travers le territoire, suscitant l'inquiétude de l'administration coloniale. Afin de lui faire barrage, elle fabrique des "partis" dont la multiplication est censée prouver que le mouvement nationaliste est minoritaire au sein des populations du Cameroun francophone. Face à l'UPC, émerge alors le Bloc des Démocrates Camerounais (BDC). Ainsi, aux consultations de 1951 (concernant les représentants du Cameroun à l'Assemblée nationale française) et 1952 (Assemblée territoriale du Cameroun), la restriction du corps électoral et la fraude permettent au Bloc de devancer l'UPC. Um Nyobe faisant acte de candidature pour la première élection est battu par son adversaire, l'abbé Meloné. Le contexte est tel que Richard Joseph précise dans Le mouvement nationaliste au Cameroun que même les adversaires de l'UPC et les fonctionnaires ne purent nier qu'il y avait eu simulacre d'élection. [9]
De la date de sa naissance (1948) à celle de son interdiction (1955), l'UPC met en pratique un programme de collaboration nationale impliquant ouvertement le dépassement politique et social du fait tribal. Dans sa volonté de lui faire barrage, le pouvoir colonial multiplia en bonne logique à son encontre des formations prenant appui sur des divisions ethniques. Leur dénomination affiche clairement leur raison d'être : contredire frontalement les deux idées fondamentales d'indépendance et de réunification du territoire incarnées par l'UPC. Involontairement, le pouvoir colonial reconnait cette réalité lorsqu'en 1952, son représentant spécial à la deuxième session du Conseil de l'ONU précise que le seul parti plus ou moins national est l'UPC (...) le seul parti qui ait des liens extérieurs de quelque importance, et qui est représenté dans chaque région du territoire.
Les évènements de mai 1955 à décembre 1956 : la rupture entre l'UPC et les autorités françaises et camerounaises modifier

En mars 1955, le Haut-commissaire Roland Pré ouvre une instruction contre Um Nyobe en raison d'une double plainte remontant à 1953 opposant le dirigeant indépendantiste au chef de subdivision de Ngambé [10]. L'affaire se conclue par un non-lieu mais Um Nyobé est contraint à la clandestinité. A Pâques, la lettre des cinq vicaires apostoliques du Cameroun est lue aux fidèles. Elle met en garde les chrétiens non pas contre la cause de l'indépendance qu'il défend mais contre l'esprit qui anime le parti politique de l'UPC. Au mois de mai , plusieurs manifestations sont réprimées par le feu comme à Loum, Douala, Yaoundé, Ngambé. Les victimes se chiffreraient en plusieurs milliers à travers le pays. La veuve de Félix-Roland Moumié, successeur de Um Nyobe depuis son assassinat le 13 septembre 1958 estime vraisemblable le chiffre de 5000 victimes de la répression française. Estimation déjà évoquée à l'époque par le délégué indien intervenant au bureau du Conseil de tutelle de l'ONU. Le 13 juillet 1955, le Gouvernement Edgar Faure publie un décret interdisant l'UPC [4]. Simultanément, un mandat d'arrêt est lancé contre Um Nyobé. Alors gouverneur de la Côte d'Ivoire après avoir officié en Indochine, Pierre Messmer remplace Roland Pré, rappelé en France début 1956 par le ministre de la France d'Outre-mer, Gaston Defferre. Pierre Messmer se heurte dès son arrivée au Premier ministre André-Marie Mbida soucieux d'affirmer son autorité, y compris face à l'administration coloniale et dont la désignation est issue de la loi-cadre Defferre.
A son arrivé, il précise que mon expérience en Indochine m'avait appris comment traiter une insurrection communiste. Messmer campe d'abord sur les positions traditionnelles du pouvoir métropolitain. Il s'agit de réaffirmer le maintien de la tutelle confiée à la France et de mettre en œuvre ce qu'il appelle une politique de containment. Néanmoins, il tente une médiation discrète en s'appuyant sur un prélat catholique, évêque de Douala et lui-même d'origine Bassa : Mgr Thomas Mongo[11]. Ce dernier rencontre Um Nyobe et leur entretien se conclu par un accord reposant sur cinq points : suppression de l'autodéfense, retrait des troupes militaires, annulation des poursuites, amnistie, ouverture de pourparlers avec le gouvernement français. Mgr Mongo transmet les demandes mais les négociations tournent court puisque l'administration coloniale constate que l'UPC maintient intacte sa volonté de réunification du Cameroun et de souveraineté nationale. L'indépendance du Cameroun, dans sa vision néocoloniale, exige l'éradication préalable de l'organisation upéciste dont l'audience de masse est manifeste[10]. Paris écarte donc André-Marie Mbida considéré comme trop incontrôlable.
En , Pierre Messmer décide de convoquer des élections alors que l'UPC n'est toujours pas autorisée et que l'administration favorise tous ces partis hostiles à l'UPC[12]. Messmer souhaite alors {{citation|[accorder] l'indépendance à ceux qui la réclamaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la réclamaient avec le plus d’intransigeance. Cette éviction de l'UPC des élections fait dégénérer la situation en conflit armé.
La guerre «contre-subversive» française au Cameroun (1956-1970)
La répression par le gouvernement colonial français (1956-1960) modifier
Les premiers attentats de l'UPC et l'isolement de la rébellion en Sanaga-Maritime (1956-1957) modifier
Au début de la guerre, tous les regards sont dirigés sur la Sanaga-Maritime.[13] Le CNO créé la veille de l’élection de décembre 1956, entre en phase de rébellion pendant que Um Nyobé se réfugie dans cette région. En parallèle, la rébellion bamiléké débute dans la région de l’Ouest, suite à l’arrestation de Pierre Kandem Ninyim, un chef nationaliste du village de Baham et sympatisant de l’UPC. Ninyim est un jeune homme de 23ans et chargé d’organiser la sédition par le parti indépendantiste.[14] Pierre Messmer est à la tête de cette arrestation dans le cadre de l’offensive lancée la veille des élections de 1956 contre l’Union nationale.[15] L’inculpation génère des violences ce qui explique la peine, de deux ans à l’origine, est réduite. Ninyim est libéré avant d’être de nouveaux incarcéré quinze jours plus tard pour cause de complicité “dans des coups et blessures “. De par cet acte, la France déclenche les hostilités. Le CNO, présent en Sanaga-Maritime, est rejoint par le mouvement “Sinistre de la défense nationale kamerunaise” ou SDNK.[13] Il peut s’agir d’un groupe issu de chefferies camerounaises ayant été “sinistrées” par les forces de l’ordre française. Ces deux mouvements agissent en coopération et sont nationalistes. Alors que la France laisse croire que le Cameroun, de par les élections de 1956, est intégré dans l’Union française, la situation s’aggrave. Le CNO et le SDNK sont sur le point de créer une révolte sur le territoire entier. Au cours de l’année 1957, le CNO se structure en Sanaga-Maritime[16]. Le mouvement s’allie avec Ruben Um Nyobè toujours réfugié au sein d’un des nombreux maquis établis dans la région. La Sanaga-Maritime s’avère est une zone propice au camouflage de par ses forêts denses. Le CNO se lance dans le recrutement de partisans et d’améliorer son organisation en établissant une hiérarchie militaire. Des “généraux” ou des “capitaines” se voient à la tête de “régiment” d’une taille de cent cinquante à deux cents hommes. Afin de masquer cette activité militaire, ces groupes prennent l’apparence d’équipes de football. Derrière cette fausse activité sportive se cache un vraie apprentissage du maniement des armes. L’UPC, depuis sa création, s’est faite des alliés ce qui permet de camoufler les partisans itinérants de le CNO derrière des associations variées[17]. L’apport de ressource jusqu’au maquis est possible grâce à ces alliances. Du côté du SDNK, l’organisation est pris en charge par Martin Singap tandis que le commandement militaire est tenu par Pierre Simo qui est désigné “capitaine général”[18]. Lors de sa création à Baham, le mouvement aurait rassemblé mille cinq cents à deux milles personnes, selon Joseph Noumbi, élu conseiller lors de la création dudit groupe. Tout comme le CNO, le SDNK cache ses activités et unités militaires sont cachées derrière des équipes de sport comme de football ou de volleyball. Petit à petit et afin de grossir les rangs, le recrutement s’opère de plus en plus par la force et la contrainte. Les recrues sont enlevés de nuit puis forcées à commettre un crime sur ceux jugés de traîtrise afin de ne plus pouvoir retourner à une vie légale[19]. Des attaques majeures sont à la suite organisées. Dans la nuit du 13 au 14 octobre 1957, la chefferie du Baham est attaquée. Le palais du chef, Jean-Marie Téguia est vandalisé mais ce dernier échappe à l’attentat. Toute chefferie collaborant avec l’administration peut être ciblée. Le but est avant tout psychologique plus que militaire[20]. Des mesures sont prises en charge par la police régional en octobre 1957. La région est ratissée et un couvre-feu est établi. Cependant, cela ne suffit pas et de nouvelles offensives sont prises comme à Batoufam où la chefferie est brûlée dans la nuit du 13 au 14 décembre et le député, Samuel Wanko, élu le 23 décembre 1956, est assassiné.
La ZOPAC ou la création d'une «zone sanitaire» en Sanaga-Maritime (décembre 1957-décembre 1958) modifier

Les méthodes de répressions varient d’une région à une autre[21]. Pour la Sanaga-Maritime, en 1958, un nouveau procédé voit le jour, particulièrement efficace en milieu tropical[22]. Il s’agit de la Zone de pacification de la Sanaga-Maritime ou ZOPAC, dirigé par le lieutenant-colonel, Jean Lamberton. Même si l’échos ne se fait pas en France métropolitaine, il est possible d’utiliser le terme de “guerre” pour qualifier la situation au Cameroun à partir de 1957. Les militaires ont un droit d’action très large dès ce moment. Jean Lamberton dirige un bataillon de tirailleurs. Le lieutenant-colonel s’est déjà illustré en Indochine, pour sa lutte anti-coloniale et ses écrits théoriques sur la façon de combattre le vietminh[23]. Il ne fait aucun doute que son impact sur la lutte contre les nationalistes est important. La doctrine de la «guerre révolutionnaire», ou DGR, apparaît donc en 1957[24]. Il s’agit de séparer les insurgés de la population locale en créant des camps de regroupement. D’un côté, une population dite «saine», non-influencé par des idées indépendantistes, est endoctrinée. De l’autre, les personnes dites «contaminées» sont éliminées. Il s’agit d’un véritable quadrillage de la population qui permet un contrôle du corps social. Un «Dispositif de protection urbaine» est créé, permettant un contrôle par zone centrée, comme par rue, et de faciliter considérablement la propagande contre-subversive. Il s’agit également de récupérer des informations par des interrogatoires musclés[25]. le mot «torture» n’est pas mentionné dans les textes officiels mais le rapprochement est possible. Le recrutement de locaux est organisé afin de contrer les révoltés. Le but est de mater l’insurrection grâce la population elle-même. Cela fait une confusion entre des militaires qui exercent le pouvoir ainsi que des civils accomplissant les tâches de ces derniers. Un climat de guerre civile règne donc. Um Nyobé, en 1957, est favorable à une solution pacifiste en premier lieu[26]. Il lance une main tendue au Premier ministre camerounais, Mbida, en écrivant un texte L’amitié franco-kamerunaise, le 27 août 1957. Ce texte est une mise-en-garde sur une confrontation qui serait irréparable pour le pays et propose la réintégration de l’UPC dans le champ politique[27]. En guise de réponse, le texte de Um Nyobé est censuré. Le CNO, par la suite, organise vingt-sept attentats de juillet à août. Um Nyobé abandonne toute idée de dénouement pacifiste. Malgré le fait que les indépendantistes sont mal armées, ils restent insaisissables, cachés dans les maquis[28]. Le 9 novembre 1957, Mbida se rend à Boumnyebel pour un discours dans lequel il lance un ultimatum aux indépendantistes des maquis[29]. Il leur donne dix jours pour se rendre. Dans le cas d’un refus, Mbida menace de renforcer son autorité avec une interdiction de circuler après 19 heures et un regroupement de la population prêt des axes routiers. Ces menaces sont un habillement politique cachant le fait que la France souhaite passer à la vitesse supérieure dans la répression. Le personnel est remplacé du côté de l’administration. Christian du Crest de Villeneuve prend le commandement armé. Jean Lamberton connaît une promotion et Louis le Puloch, un général téméraire, est envoyé au Cameroun. Ces trois nouveaux acteurs s’illustrent comme les dirigeants militaires de la ZOPAC. En revanche, le vrai précurseur est Daniel Doustin. Il est discret ce qui peut expliquer qu’il soit méconnu. Il a une grande connaissance de la situation et de la politique camerounaise. Bien qu’il soit contre la politique de Messmer et aurait préféré une solution diplomatique, Doustin rédige la ligne directrice de la ZOPAC. Il rédige également un plan d’ensemble à une propagande massive afin de rendre toute la population hostile à l’UPC. Il est ironique de voir que ces plans, suivis à la lettre, sont jugés mauvais par leur architecte lui-même. La ZOPAC est une zone s’établissant de décembre 1957 à décembre 1958[30]. Son but est est de soustraire la population à l’influence indépendantiste. Il y a tout un aspect psychologique qui tourne autour de diabolisation des idées d'indépendances. La masse doit être délivrée de l’«intoxication» indépendantiste[31].
L'extension et la répression de la rébellion en pays Bamiléké (1957-1960) modifier

Si la Sanaga-Maritime est une région où des recherches sont entreprises par l’autorité française dans le but d’une répression, elle n’est pas la seule[32]. La zone bamiléké est aussi ciblée pour mater les révoltes et la France y a des alliés. Maurice Delaunay est à la tête de cette région depuis juin 1956[33]. Il est un farouche opposant à la cause nationaliste et en fait une affaire personnel. Il est lui-même menacé par l’UPC. Il subit des menaces en 1957 par des tractes lui promettant des «attentats très agressifs» ou tenant d’autres propos violents comme «une peau blanche bien tranchée». Ces menaces peuvent s’expliquer par le fait qu’il est un homme de confiance de Pierre Messmer. Aux côtés du chef de région, des fidèles sont présents comme Jacques Hubert, spécialiste de la lutte anticolonialiste, se positionnant au poste de chef de subdivision de Bafang. Un Camerounais est également partisan. Il s’agit de Samuel Kamé, adjoint de Delaunay à Dschang. C’est un conseiller précieux, originaire du groupement de Baham, il fournit des informations clés sur la situation locale[34]. Delaunay va choisir d’utiliser les chefs de village favorable à l’administration française[35]. Un début de classe politique subordonnée à la [France]] naît peu à peu. Delaunay témoigne par la suite de la confiance qui règne au sein de ces chefs et la sympathie qu’il a pour eux et réciproquement. Néanmoins, certains se plaignent d’un manque de justice car ils sont ciblés par les attaques des insurgés bamilékés[36]. Pour obtenir la confiance des chefs, l’administration multiplie les arrestation et relâchent rarement les suspects afin d’éviter toute récidive dans les attentats ou insurrections. Delaunay proclame lui-même qu’il n’est pas nécessaire de donner trop d’intérêts aux prisonniers et que le code pénal ne s’applique pas à un pays comme le Cameroun[37]. Dans la ville de Dschang, plus de trois cents prisonniers insurgés restent emprisonnés sans avoir de date de jugement ou de libération. La défense est également lacunaire car l’avocat des membres de l’UPC, Yves Louisia, est expulsé du Cameroun le 2 novembre 1957 par Pierre Messmer. Durant plus de deux ans, la confrontation entre l’administration et les Bamilékés nationalistes est donc obscure, assombri par des manoeuvres politiques cachées et douteuses. Delaunay compose avec les chefs qui le rejoignent mais attaque ceux qui lui sont opposés[38]. Jean Rameau Sokoudjou, un nationaliste, est l’un deux et est emprisonné régulièrement à travers le pays pendant que sa chefferie est dirigée par des soldats entre novembre 1957 et juin 1958. Parmi les méfaits commis durant cette période, il témoigne du viol de sa femme à son lieu de résidence alors qu’il était ligoté. Autre méthode de Delaunay, une similaire à l’Algérie[39]. Un homme en témoigne mais souhaite rester anonyme. Il mentionne de la torture à la balançoir, ce qui consiste à mettre la tête de la victime à l’envers. Une seconde méthode est celle à l’eau. Il parle de gendarmes de Delaunay dans le rôle des tortionnaires. Plus tard, en 2005, Delaunay ne nie ni ne confirme ces exactions. Un administrateur de l’époque, souhaitant également conserver l’anonymat, est interrogé et témoigne connaître les méthodes d’interrogatoires. Il informe du fait que les interrogés sont choisis à l’aveugle et que tout le monde est suspect. Les arrestations et interrogatoires massifs font des dégâts au sein de la rébellion. Certains nationalistes se rallient de force comme Joseph Noumbi, capitaine du SDNK. Il témoigne s’être rallié de force en 1959, par la torture dont il garde toujours des traces cinquante ans plus tard, comme des traces de fer aux chevilles. Le bilan des méthodes de Delaunay est favorable à l'administration[40]. Pierre Simo, chef du SDNK prend des risques. Il organise des raids comme au Mungo mais de nombreuses arrestations ont lieu lors de ces offensives. De par la torture, beaucoup de nationalistes finissent par céder et dénoncer. Très vite, la rébellion bamiléké semble être matée. Le bilan de la répression serait catastrophique d’un point de vu démographique[41]. Pour le lieutenant-colonel, Jean Lamberton, la région aurait été dépeuplée de plus de 50%.
L'indépendance camerounaise et la répression néocoloniale (1960-1970) modifier
Le gouvernement Ahidjo et la coopération militaire franco-camerounaise modifier

Le 13 septembre 1958, Um Nyobé est assassiné par une patrouille franco-camerounaise[42]. La France, au même moment, prend en considération les désirs d’indépendance du Cameroun. Cette soudaine décision française est ironique sachant que le leader indépendantiste meurt au même moment. Cela démontre un paradoxe qui peut se résumer par une «vrai-fausse indépendance» où la France conserverait une influence. La stratégie française est de proposer une indépendance tout en maintenant l’illusion qu’elle se bat contre des terroristes qui brûlent et sabotent le pays et non contre des indépendantistes[43]. Pour se faire, Ahmadou Ahidjo devient le Premier ministre camerounais, conformément à une stratégie d’installer un gouvernement noir suffisamment docile pour obéir à la France[44]. L’illusion que le Cameroun s’administre par lui-même et de façon indépendante permet de tromper les indépendantistes et d’installer une répression plus efficace. Une omniprésence des Blancs dans l’armée et l’administration avait pour résultat de créer des tensions et des révoltes. Ahidjo est issu d’une famille modeste et devient conseiller territorial en 1947 grâce à l’influence française. En 1952, il est envoyé en France pour siéger à l’Assemblée de l’Union française[45]. Par conséquent, il intègre parfaitement les consignes françaises et s’avère être un acteur parfait afin de maintenir l’influence de la France au Cameroun. Après son investiture, le nouveau Premier ministre déclare, à la mi-février 1958, que le Cameroun «n’envisage pas de sortir du sillage de la France». Il apparaît donc comme un homme fidèle à la métropole du fait qu’il lui doit son ascension sociale[46]. Une politique d'indépendance contrôlée est donc lancée. Le 1er janvier 1960, l’indépendance officielle est déclarée avec Ahidjo à la tête du pays[47]. Ironie de la chose, le discours du Premier ministre est écrit par un Français, Paul Audat. L’UPC reste revancharde, l’indépendance en trompe-l’oeil ne calme pas les foules[48]. Quelques heures avant la déclaration, des incendies dans les plantations coloniales du Mungo se sont déclarés ainsi que des raids dans différents villages. Les Français préparent donc des opérations d’«épuration» face à ces troubles[49]. Avant le 1er janvier, des mesures sont prises pour le bon déroulement des cérémonies célébrant l’indépendance. Des trains sont mis à disposition afin de renvoyer toute personne non-employée ou suspecte. Dans un rapport militaire daté du 16 décembre 1959, le terme d’«épuration» est utilisé pour qualifier une opération dans un quartier congolo-sénégalais de Douala. Toute personne ne se livrant à aucune activité professionnelle doit être refoulée dans son pays d’origine. Soixante-quinze personnes sont expulsées. Trois jours plus tard, trois cents quatre-vingt quatre personnes sont également refoulées, dont trois cents quatorze bamilékés, «sur leur pays d’origine».
La poursuite de la répression en pays Bamiléké (1960-1964) modifier
En 1960, la situation de l'UPC est très difficile. En novembre 1960, Félix Moumié se rend en Suisse pour acheter des armes et rencontrer des diplomates de la République Populaire de Chine, mais est empoisonné par les services de renseignements extérieurs français et meurt le 3 novembre 1960. Les rangs des rebelles se vident également face à la répression franco-camerounaise et l'organisation manque de moyens financiers et d'équipements militaires. Malgré quelques livraisons tchécoslovaques et chinoises d'armes, le blocus maritime mené par les marines françaises et camerounaises empêche l'arrivée d'importantes livraisons sur les côtes camerounaises[50]. L'UPC souffre également d'un manque de cohésion et de coordination. Le 13 septembre 1962, une «Assemblée populaire sous maquis» à lieu dans le Mungo à l'ouest du Cameroun. Elle aboutit à la création d'un Comité Révolutionnaire dirigé par Ernest Ouandié et l'attestation d'un double-commandement : Ernest Ouandié dirige le maquis et Abel Kingué dirige les membres en exil et tente de trouver du soutien sur la scène internationale[51]. Mais des fractures idéologiques entraînent des scissions dans le parti et opposent Ouandié à Kingué et Afana[52]. Les conflits internes de l'UPC lui font perdre sa crédibilité et le parti peine à trouver des soutiens à l'échelle internationale. En 1964, la mort d'Abel Kingué au Caire fait à nouveau perdre à l'UPC un de ses principaux leaders politiques.
Dans le camp adverse, l'armée camerounaise est formée et équipée par les troupes françaises conformément au traité de Yaoundé. En 1964, on dénombrerais pas moins de 100 000 soldats chargés de la répression de la rébellion et bénéficiant du soutien aérien français[53]. Malgré les réfutations des chefs militaires français, il semblerait que l'aviation française ai utilisé des bombes au napalm pour bombarder les rebelles et les villages de la région Bamiléké sans discernement. Ces attaques auraient provoquer de nombreuses victimes dans la population civile sans qu'un chiffre puisse être avancer. Le 1er janvier 1961, les Groupements tactiques Nord et Sud de l'armée française sont dissous et laisse l'armée camerounaise mater la rébellion[54]. Mais les troupes françaises restent présentes pour appuyer toute opération militaire et camerounaise et conseiller le commandement camerounais. Les forces camerounaises poursuivent la répression par la destruction de villages, la torture etc. Des groupes d' «auto-défense» sont créés pour appuyer les forces camerounaises et harceler les rebelles upécistes[55]. La destruction de villages dans les régions rebelles par les troupes camerounaises se seraient poursuivis jusqu'en 1963, moment où la rébellion semble vaincue selon les autorités françaises[52]. Le 31 décembre 1964, la mission française dirigée par le colonel Aufèvre, remplaçant du général Briand à la tête des troupes françaises depuis 1962, est officiellement terminée.
Le retrait français et l'arrestation des derniers chefs de l'UPC (1964-1970) modifier
En 1964, la fin de la mission française au Cameroun ne marque pas la fin de la répression. Les forces camerounaises continuent de surveiller et attaquer les derniers maquis existants mais les exactions sur les populations civiles semblent s'atténuer voir disparaître. Les chefs de l'UPC cherche en vain à recréer des maquis et à s'approvisionner en armes : l'upéciste Osendé Afana, réfugié en Egypte et dans la République du Congo, cherche à organiser un maquis le long de la frontière entre le Cameroun et la République du Congo avec le soutien de ce-dernier. Son action dans la région est méconnue mais sa tentative est un échec et il est capturé puis exécuté lors d'un affrontement avec l'armée camerounaise le 15 mars 1966[56]. Ses troupes s'enfuient et partent recevoir une formation militaire auprès de combattants angolais et cubains. A la fin de l'année 1967, ils forment la troupe «Ruben Um Nyobé» et entrent au Cameroun mais sont rapidement vaincus par les forces camerounaises. Un coup d'Etat dans la République du Congo en 1968 permet la signature d'accords entre le Cameroun et le Congo et met fin au espoir de créer un nouveau front upéciste à l'est du Cameroun[57].
A l'ouest du Cameroun, Ernest Ouandié dirige les derniers rebelles upécistes dans la région Bamiléké. En août 1970, le leader upéciste cherche à quitter le Cameroun avec l'aide de l'évêque Albert Ndogmo mais il est piégé par l'armée camerounaise. Son collaborateur Mathieu Njassep est capturé le 12 août et Ouandié se rend le 20 août 1970[58]. Les deux hommes sont transférés dans la capitale Yaoundé et sont torturés durant plusieurs mois. Du 21 décembre 1970 au 5 janvier 1971, le procès des derniers leaders de l'UPC est organisé à Yaoundé. Ernest Ouandié, Mathieu Njassep, Raphaël Fosting, Gabriel Tabeu et l'évêque Albert Ndogmo sont condamnés à mort. La peine de Njassep et Ndogmo est commuée en prison à vie et les trois autres condamnés sont exécutés le matin du 15 janvier 1971. La hiérarchie de l'UPC décapitée, le gouvernement Ahidjo estime désormais que la rébellion upéciste est vaincue[59].
Une guerre meurtrière et oubliée modifier
Un bilan humain difficile à évaluer modifier
Le coût humain de la guerre du Cameroun est impossible à évaluer. Les auteurs de Kamerun : une guerre cachée aux origines de la Françafrique (1948-1971) nous le disent : «Le propre de la guerre révolutionnaire étant d'abolir la distinction entre civils et belligérants, les pertes au sein des combattants et des populations s'entremêlent sans que l'on parvienne à les dénombrer.» Dans le camp upéciste, il est impossible d'évaluer précisément le nombre de massacre et de morts perpétués. Les groupes agissaient indépendamment et on ne comptait guère les morts. Dans le camp franco-camerounais, des milices paramilitaires agissaient indépendamment et leurs actions n'étaient pas contrôlées par les autorités, les bombardements aériens français rasaient des zones urbaines sans aucun bilan humain à la fin des opérations et les milliers de morts dans les camps de de regroupement de populations n'étaient pas décomptés. Les autorités franco-camerounaises ne connaissaient pas réellement l'impact de leur actions armées et avaient tout intérêt à cacher les conséquences de cette guerre à la communauté internationale. Le bilan proposé par les deux camps restent donc à prendre avec précaution. Du côté upéciste, on parle régulièrement de génocide, notamment du peuple Bamiléké. Du côté franco-camerounais, les chiffres présentés sont parfois étrangement faibles. Selon les bulletins de renseignements du commandant supérieur de la Zone d'Outre-Mer n°2, «les pertes rebelles en pays bamiléké et dans le Mungo voisin auraient été de 28 tués entre le 1er janvier et le 30 juin 1959», alors que le colonel français Jean Lamberton estime que «la région a été dépeuplé à 50%»[60] lors d'une réunion de l'état-major de la zone AEF-Cameroun du 3 janvier 1959. La disparité des chiffres montre une méconnaissance du véritable bilan et une tentative de manipulation de la vérité sur l'action armée franco-camerounaise. Les autorités camerounaises réduisent ces chiffres à quelques «milliers de victimes civiles»[61]. Le point de vue de Martin Ebele-Tobbo, fonctionnaire des nations Unies au Kenya, peut également être pris en compte. Il annonce le chiffre de 500 000 morts en pays Bamiléké et 80 000 morts en Sanaga-Maritime entre 1956 et 1960. Enfin, l'historien français Marc Michel, spécialiste de l'Afrique coloniale, estime que «plus vraisemblablement, la guerre a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, principalement des victimes de la guerre civile, après l'indépendance». La disparité des chiffres proposés par les différents acteurs et observateurs ne permet donc pas d'établir des données précises sur le bilan humain de cette guerre.
L'Etat français : du déni à la reconnaissance ? modifier

La guerre du Cameroun est un évènement oublié en France et peu de français d'hier et d'aujourd'hui connaissent son existence. Tournés vers la guerre d'Algérie (1954-1962), les journalistes n'ont que peu dénoncé les massacres perpétrés par l'armée française.[62] Le conflit algérien touchait trois départements français et engageait 1,5 millions de jeunes français appelés au service militaire alors que la répression au Cameroun avait lieu sur un territoire sous tutelle éloigné de la métropole et n'engageant que des militaires professionnels. La mémoire du conflit resta oubliée en France et se perpétua au Cameroun notamment par l'intermédiaire des intellectuels. Le philosophe camerounais Achille Mbembe s'intéresse notamment au mouvement nationaliste camerounais dès les années 1980 et des étudiants cherchent à exhumer les archives et recueillir des témoignages dès les années 1990. Mais les Etats français et camerounais continuent de nier l'existence de ses massacres ou de les réduire à quelques «milliers de victimes civiles» selon le ministre Sadou Daoudou des forces armées du Cameroun en 1979. En mai 2009, une visite du premier ministre François Fillon à Yaoundé illustre ce refus de l'Etat français de reconnaître sa participation à des actions armées au Cameroun dans les années 1950 et 1960. Répondant à une question sur le rôle de la France dans les évènements qui se déroulèrent au Cameroun au moment de l'indépendance, François Fillon répondit : «Je dénie absolument que des forces françaises aient participé, en quoi que ce soit, à des assassinats au Cameroun. Tout cela c'est de la pure invention»[63]. Le 3 juillet 2015, le président de la République française François Hollande réalise la première visite d'un président français au Cameroun depuis 1999. Il y déclare alors : «C'est vrai qu'il y a eu des épisodes tragiques dans l'Histoire. Il y a eu une répression dans la Sanaga-Maritime en pays Bamiléké et je veux que les archives soient ouvertes pour les historiens»[64]. Cette déclaration brise un tabou sur cet évènement historique et peut ouvrir la voie vers une reconnaissance de cette guerre par l'Etat français.
Une historiographie naissante modifier
La réalisation de cet article s'est principalement basée sur les ouvrages Kamerun! : Une guerre cachée aux origines de la Françafrique (1948-1971) et Kamerun, l'indépendance piégée : De la lutte de la libération à la lutte contre le néocolonialisme. Ces deux ouvrages sont des livres d'investigation cherchant à expliquer et dénoncer les crimes commis par l'armée française au Cameroun. Le premier ouvrage a été écrit par Thomas Deltombe et Manuel Domergue, journalistes français, et Jacob Tatsitsa, historien camerounais et le second est l'œuvre de Jean Chatain, journaliste à l'Humanité, et de Augusta Epanya et Albert Moutoudou, deux membres actuels de l'UPC. Ces ouvrages sont des œuvres de dénonciation qui peuvent parfois avoir une «vision manichéenne». C'est cette expression qu'emploie l'historien Marc Michel pour parler de l'ouvrage de Thomas Deltombe[65], Manuel Domergue et Jacob Tatstitsa. Il salue le travail d'enquête mais critique l'utilisation de «multiples sources secondaires invoquées, [soient] souvent placées hors contexte, et pratiquement toutes dans un seul sens, laissant de côté celles qui n'arrangent pas» et estime que «les auteurs cherchent moins à analyser l'évolution des forces économiques, sociales et politiques de ce pays [Cameroun] compliqué, [...], qu'à instruire un procès». Les travaux sur la guerre du Cameroun n'en sont donc qu'à leur début et penchent davantage vers le journalisme d'investigation que vers la recherche historique. Des recherches historiques ont néanmoins été mené par des universitaires camerounais tel que Noumbissie Mä Tchouaké et l'historien Marc Michel qui a publié Une décolonisation confisquée, Perspectives sur la décolonisation du Cameroun sous tutelle de la France (1955-1960) dans la Revue française d'Histoire d'Outre-Mer.
Notes et références modifier
- « Charles Lacheroy ». Les amis de Raoul Salan - le bulletin no 04 1er trimestre 2005
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 60.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 50.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 43.
- Deltombe 2011, p. 283.
- Abel Eyinga, L’UP : une révolution manquée ?, Chaka, p. 23-24
- Enoh Meyomesse, Le carnet politique de Ruben Um Nyobè, p. 20
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 42.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 65.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 45.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 44.
- "Survie".Cameroun-la guerre d'indépendance : une histoire toujours taboue
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 287.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 290.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 288.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 291-292.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 294.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 295.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 296.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 299.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 321.
- Deltombe 2011, p. 322.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 324.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 325.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 326.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 327.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 328.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 330.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 331.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 336.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 356.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 304.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 305.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 306.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 307.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 308.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 309.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 310.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 315.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 318.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 319.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 391.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 395.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 400.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 401.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 403.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 495.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 498.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 499.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 101-102.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 103-104.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 104.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 107.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 97.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 101.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 104-105.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 105-106.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 106-107.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 108-109.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 31.
- Chatain, Epanya et Moutoudou 2011, p. 841.
- Deltombe 2011, p. 13.
- Deltombe 2011, p. 25.
- "RFI".Au Cameroun, François Hollande brise un tabou 3 juillet 2015
- Marc Michel, critique du livre Kamerun, Études coloniales, 21 mars 2011
Bibliographie modifier
Monographies modifier
- Jean Chatain, Augusta Epanya et Albert Moutoudou, Kamerun, l'indépendance piégée : De la lutte de la libération à la lutte contre le néocolonialisme, L'Harmattan, .
- Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatsitsa, Kamerun ! : Une guerre cachée aux origines de la Françafrique 1948-1971, La Découverte, .
Articles modifier
- Augustin Mensah, « Cameroun - la guerre d’indépendance : une histoire toujours taboue », Survie, no 206, (lire en ligne).
- Marc Michel, « Une décolonisation confisquée ? Perspectives sur la décolonisation du Cameroun sous tutelle de la France 1955-1960 », Outre-mers, nos 324-325, , p. 229-258 (lire en ligne).
- Noumbissie Mä, « La construction de l'imaginaire socio-politique bamiléké et les prémices de la rébellion dans l'Ouest-Cameroun », Outre-mers, , p. 243-269 (lire en ligne).
- Thomas Deltombe, Manuel Domergue, Jacob Tatsitsa, François Gèze, Ambroise Kom, Achille Mbembe et Odile Tobner, « La guerre coloniale du Cameroun a bien eu lieu », Le Monde, (lire en ligne).